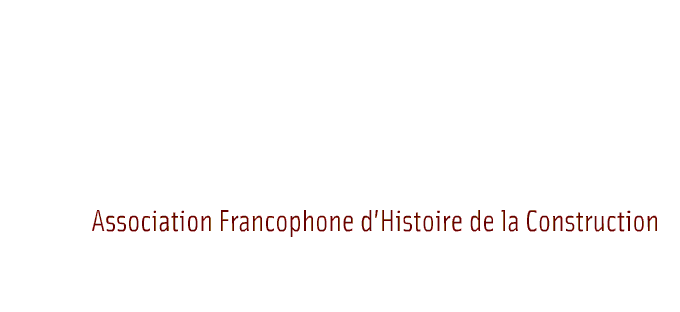Séminaire Histoire de la construction
Organisé par
Le Centre de théorie et analyse du droit
(CTAD) UMR 7074, CNRS – Université Paris Nanterre
Le Laboratoire Archéologie et Philologie
d’Orient et d’Occident (UMR 8546, ENS-CNRS-EPHE)
Le laboratoire Orient & Méditerranée. Textes
Archéologie Histoire (UMR 8167, CNRS-Sorbonne Université-
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
et
L’Université de Lausanne
Mardi 28 janvier 2025
de 10h à 17h
L’expérimentation constructive
10h Introduction
10h15 Christel Palant, ENSA Paris- Val de Seine
À la recherche de nouveaux produits industrialisés : les expériences constructives en France pendant les Trente Glorieuses
11h15 Luigi Veronese, Architecte, Università Federico II de Naples
Maiuri’s restorations. Sperimentation and Modern works in Campania: Pompei, Ercolano, Baia, Cuma, Capri (conférence en anglais)
12h30-14h Déjeuner
14h Guy Lambert, ENSA Paris-Belleville
L’expérimentation d’une doctrine de l’expérimentation au Plan Construction (1971-1982)
15h François Fleury, ENSA Normandie
Expérimentation de la voûte plate à claveau unique proposée par Joseph Abeille (1699) 16h15 Revue de publications récentes sur l’histoire de la construction
Résumés
Maître de conférences en histoire et cultures architecturales à l’Ecole d’architecture de Paris-Val de Seine, Christel Palant est docteur de l’université Paris I, où elle a soutenu une thèse de doctorat sur « Les ingénieurs-conseils dans l’architecture en France, 1945-1975 : réseaux et internationalisation du savoir technique » sous la direction d’Antoine Picon en 2009. Un post-doctorat au Centre d’histoire sociale du XXe siècle, sous la direction de Danièle Voldman et Annie Fourcaut en 2010-2011, sur la genèse des grands ensembles lui a permis de poursuivre ses recherches sur l’industrialisation de la construction en Europe, en particulier autour de la réorganisation des chantiers et de la production du logement, à travers l’émergence des bureaux d’études techniques indépendants. En 2014-2015, un contrat de chercheur au Service régional de l’Inventaire de la Région Centre-Val de Loire lui a permis d’orienter ses recherches sur la Reconstruction en France et en particulier sur les questions matérielles et professionnelles, autour des chantiers de construction.
À la recherche de nouveaux produits industrialisés : les expériences constructives en France pendant les Trente Glorieuses
Après les expériences constructives menées pendant la Seconde Guerre mondiale et mises en œuvre à la Libération, la décennie suivante montre un tournant dans la production des différents éléments qui composent l’architecture. La nécessité de produire vite et en grand nombre pour répondre à une demande massive de logements et d’équipements conduit les acteurs de cette période – architectes, entrepreneurs, ingénieurs, industriels – à expérimenter d’autres manières de faire, d’autres manières de travailler et de collaborer, mais aussi d’autres manières de penser et produire l’architecture. Loin d’être anecdotiques, ces expériences ont radicalement transformé notre cadre de vie. Derrière des logiques souvent économiques et productivistes se cachent des expérimentations souvent dominées par les fleurons de l’industrie française. À partir de quelques exemples, notre communication portera sur les expérimentations constructives menées en France durant les Trente Glorieuses.
Bibliographie sélective :
Labidurie Boris et Palant Christel, Les fonds iconographiques et audiovisuels de la Reconstruction, 1940-années 1960, Actes du colloque d’avril 2021, Paris, Publications des Archives nationales, coll. « Actes », 5 octobre 2023 [en ligne : https://books.openedition.org/pan/2911].
Buffler Éléonore, Gourbin Patrice, Palant Christel, Protéger, valoriser, intervenir sur l’architecture et l’urbanisme de la Seconde Reconstruction en France : actualité et avenir d’un patrimoine méconnu, Actes du colloque de 2018 à Saint-Dié-des-Vosges, Gand, éd. Snoeck, janvier 2020.
Palant-Frapier Christel, « Le Loiret, chantier pilote de la Reconstruction », in Cohen Jean-Louis, Architecture, arts et culture dans la France de Vichy, Actes du colloque du Collège de France en juin 2016, Paris, éd. Collège de France, 2020, p. 125-135.
Palant-Frapier Christel, « L’émergence des bureaux d’études techniques en France autour de 1950 », Entreprises et histoire, n°71, juin 2013, p. 100-110.
________________________________________________________________________
Luigi Veronese, architecte, docteur en conservation du patrimoine architectural et du paysage, enseignant-chercheur (« ricercatore di restauro architettonico ») auprès du département d’architecture de l’Università Federico II de Naples. Il a été conservateur architecte auprès du Ministère de la Culture italien. Il enseigne la restauration de l’architecture auprès du département d’architecture (DiARC) et du département d’ingéniérie civile et environnementale (DICEA) de l’Università Federico II de Naples. Il fait partie du collège des enseignants de la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio de l’Università Federico II de Naples et, dans la même université, du doctorat Habitat in Transition (Habit) e du Master de niveau II Restauro e Progetto per l’Archeologia. Il est l’auteur de nombreuses publications dans des volumes et revues scientifiques et a participé à des projets de recherche nationaux et internationaux dans le domaine de la connaissance, de la restauration et la valorisation du patrimoine architectural et archéologique. Ses recherches portent sur la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et s’intéressent en particulier à l’histoire et aux théories de la restauration dans la première moitié du XXe siècle. Il vient de publier une monographie sur la figure emblématique d’Amedeo Maiuri et la restauration (Amedeo Maiuri e il restauro. La tutela dei siti archeologici in Campania tra le due guerre, Artem, Napoli, Naples, 2024).
Maiuri’s restorations. Sperimentation and Modern works in Campania: Pompei, Ercolano, Baia, Cuma, Capri (conférence en anglais)
Exactement cent ans après le début de la longue expérience professionnelle d’Amedeo Maiuri à la tête de la Surintendance napolitaine des antiquités, en 1924, une enquête rigoureuse sur le travail de l’archéologue, du point de vue particulier de l’architecte restaurateur, met en lumière les critères, les résultats et les techniques des chantiers de restauration des sites archéologiques de Campanie dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. C’est à cette époque que la conservation et la mise en valeur de sites importants tels que Pompéi, Herculanum, Paestum, Baia, Villa Jovis à Capri et Liternum, ont donné lieu à une relecture instrumentale de la Rome antique à des fins d’affirmation politique et de propagande. Dans ce cadre général, la contribution d’Amedeo Maiuri à la redéfinition des stratégies de la restauration moderne est reconstituée, en mettant en évidence les matériaux et les techniques de consolidation, les méthodes de fonctionnement du chantier de restauration et les choix de conception pour la valorisation des sites.
Bibliographie sélective
L. Veronese (2024), Amedeo Maiuri e il restauro. La tutela dei siti archeologici in Campania tra le due guerre, Artem, Napoli, p. 335.
L. Veronese (2024), Il restauro per la lettura e la fruizione di un palinsesto archeologico: l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere in Restauro dell’architettura. Per un progetto di qualità, coordinamento a cura di S. Della Torre, V. Russo, Sezione 4: Indirizzi di metodo a cura di M. Docci, Quasar, Roma, p. 842-850.
L. Veronese (2023), Archeologia nel paesaggio. I Campi flegrei nella prima metà del XX secolo: tra restauro e fruizione. In Amedeo Maiuri: l’archeologia e il paesaggio storico del golfo di Napoli. Atti della Giornata di Studi a 90 anni dallo scavo di Villa Jovis (Capri, 28 Ottobre 2022), a cura di L. Di Franco, R. Perrella, Quasar, Roma 2023, p. 195-210.L. Veronese, L. Cappelli (2022), L’UNESCO e la ‘democratizzazione della cultura’. Siti archeologici nel centro antico di Napoli tra accessibilità e fruizione inclusiva. In “Restauro Archeologico” 1972-2022 Il patrimonio mondiale alla prova del tempo, numero speciale, Vol. 1, p. 196-201.
L. Veronese (2019), Giovannoni e la Commissione ministeriale per lo studio delle strutture del Pantheon. In “Quaderni degli Atti dell’Accademia Nazionale di San Luca”, Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, a cura di G. Bonaccorso e F. Moschini, p. 31-38.
L. Veronese (2019), Una nuova idea di paesaggio. William Turner e l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. In “RA – Restauro Archeologico”, Memories on John Ruskin – Unto this last, numero speciale a cura di S. Caccia Gherardini, M. Pretelli, Didapress, Firenze, p. 148-155
L. Veronese, R. Picone, A. Spinosa (2016), L’influence de la culture académique francaise dans le domaine de la restauration en Italie meridionale entre XIXème et XXème siècle. L’Ecole de Ponts e Chaussés à Naples. In F. Fleury, L. Baridon, A. Mastrorilli, R. Mouterde, N. Reveyron (a cura di), Les Temps de la construction. Processus, acteurs, matériaux, p. 905-913, Picard, Parigi, ISBN: 9782708410053.
L. Veronese (2015), Il parco archeologico di Baia. La tutela del paesaggio come strumento di tutela del sito antico. In S. Bertocci e S. Van Riel (a cura di), La cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza, Alinea, Firenze, p. 1053-1060, ISBN: 9788860558299.
L. Veronese (2012), Villa Jovis a Capri: lo scavo e il restauro negli anni del regime. In « Confronti. Quaderni di restauro architettonico » L’architettura allo stato di rudere. vol. 0, Arte’m Napoli, ISBN: 9788856901856, p. 20-31.
___________________________________________________________
Guy Lambert est maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (UMR AUSser). Ses recherches portent sur les interactions entre architecture, techniques et société aux XIXe et XXe siècles, sous l’angle de l’histoire culturelle et matérielle. Il a consacré de nombreux articles à la rationalisation des chantiers au XXe siècle, depuis Perret jusqu’à l’industrialisation du bâtiment. Parmi ses publications récentes, il a notamment coordonné Pannes et accidents (XIXe-XXIe siècle) au cœur de l’économie, des techniques et de la société (dir. avec Olivier Raveux, Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines, n° 11), 2020 ; Les architectes et la fonction publique. XIXe-XXIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022 (dir. avec Catherine Bruant et Chantal Callais) et La perspective de l’accident. Quand la construction défaille… (dir. avec Robert Carvais, Ædificare. Revue internationale d’histoire de la construction, n° 12), 2024.
L’expérimentation d’une doctrine de l’expérimentation au Plan Construction (1971-1982) Créé en mai 1971 sous la tutelle du Ministère du Développement Industriel et Scientifique et du Ministère de l’Équipement et du Logement, le Plan Construction reçoit comme mission de « stimuler l’innovation » dans le domaine de l’habitat. Parallèlement à la recherche incitative, la mise en place d’un programme d’expérimentation – sous la forme de Réalisations expérimentales (REX) – participe d’une action d’acculturation en direction des professionnels et du public et représente une part emblématique de ses activités. Visant « une réalisation en vraie grandeur d’un habitat destiné à l’occupation par des usagers à titre permanent » tout en testant sur le terrain des procédés industriels de construction dans une perspective qui se veut méthodiques, la doctrine de l’expérimentation du Plan Construction peut apparaître « composite et contradictoire » après une première décennie d’exercice tant elle « reflète la diversité des aspirations, parfois discordantes », comme l’écrivent en 1982 Joseph Abram et Daniel Gros chargés d’en dresser le bilan. Plus que sur les réalisations, déjà bien étudiées, cette communication interrogera la genèse de cette « doctrine » pour l’expérimentation, pensée à la fois comme un protocole scientifique à part entière et à la croisée des différentes missions du Plan Construction.
Bibliographie sélective
Guy Lambert, « La première décennie du Plan Construction 1971-1982 : stratégies éditoriales et représentations », Histoire de l’art, n° 59, octobre 2006, p. 141-151.
Guy Lambert, « Une spécificité des publications du Plan Construction (1971-1988) », in Jean-Philippe Garric, Valérie Nègre, Alice Thomine (dir.), La Construction savante. Les avatars de la littérature technique, Paris, Éditions Picard, INHA, 2008, p. 319-330.
Guy Lambert, « Les premières réalisations expérimentales du Plan Construction, entre laboratoire et démonstration », Lieux communs, Les cahiers du LAUA, « Espaces témoins », [ENSA Nantes], n° 13, septembre 2010, p. 55-72.
Guy Lambert, « Quand l’habitant expérimente par la maquette la conception : au cœur d’une expérience de logements “à la demande” de Georges Maurios et du Plan Construction (1971-1975) », in La maquette, un outil au service du projet architectural, Paris, Éditions des Cendres, Cité de l’architecture et du patrimoine, 2015, p. 148-161.
Guy Lambert, « Un ballet mécanique. Images et imaginaires des « révolutions industrielles » du chantier, XIXe-XXe siècles », in Valérie Nègre (dir.), L’art du chantier. Construire et démolir du XVIe au XXIe siècle, Paris/Gand, Cité de l’architecture et du patrimoine/Snoeck, 2018, p. 70-83.
François Fleury est ingénieur de formation et docteur en Génie Civil. Après une période comme ingénieur de recherche à EDF, il oriente ses recherches vers l’histoire de la construction lors de sa titularisation à l’école d’architecture de Lyon. Il élargit ensuite son domaine de recherche aux modes d’intégration des savoirs techniques dans la conception de l’architecture écologique avant de rejoindre l’ENSA Normandie, ou il dirige le laboratoire Architecture Territoires Environnement depuis janvier 2023. Ses principales contributions dans le domaine de l’histoire de la construction portent sur la meilleure compréhension des charpentes médiévales à chevron formant fermes et des représentations du comportement mécanique des arcs et voûtes en pierre au XVIIIe siècle
Expérimentation de la voûte plate à claveau unique proposée par Joseph Abeille (1699)
Le module de stéréotomie, taille de la pierre et construction, dispensé aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau sous la responsabilité de Joël Sakarovitch, a permis d’expérimenter à grande échelle plusieurs voûtes plates telles que conçue par M. Abeille en 1699. Sur le plan de la mécanique des structures, la stéréotomie particulière des voussoirs induit une lecture très orientée, qui décourage rapidement l’effort de compréhension au profit d’une fascination pour une stéréotomie qui serait la substance de la mécanique. Or, du point de vue strict du mécanicien des milieux continus, le problème de la voûte plate comme celui de la plate-bande se réduit à un calcul trivial de poussée. La prise en compte de la géométrie particulière des voussoirs (milieu non continu) enrichit l’analyse en introduisant des conditions de non-glissement, et leur agencement tridimensionnel réclame la construction d’un modèle déjà beaucoup plus subtil. La construction d’un modèle de comportement mécanique cohérent permet alors d’éclairer les enjeux de la stéréotomie et de la taille de la pierre du point de vue de la stabilité de l’ouvrage.
Du point de vue historique, l’invention de M. Abeille en 1699 est intéressante à plusieurs points de vue : tout d’abord elle s’inscrit dans une série historique de propositions constructives spécifiques, caractérisées par un principe de descente de charge itératif, cyclique, imbriqué ; en second lieu, s’inspirant d’un principe de plancher bois retenant l’intérêt de scientifiques et constructeurs outre-manche, cette invention peut traduire l’existence d’une composante européenne dans la culture constructive ; enfin elle apparaît en tant que révélatrice ou témoin significatif de certains enjeux de l’époque en matière de conception architecturale et de construction, tels que les processus rationnels de construction, les relations entre mécanique et stéréotomie, ou entre esthétique et mathématique.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les types d’intuition, de savoir, de représentation qui ont pu conduire au concept et au design de la voûte, ainsi que leur pertinence, à la lumière du contexte scientifique et culturel d’une part, et des différentes modélisations dont dispose l’ingénieur d’aujourd’hui d’autre part. Il s’agit de débattre de l’origine, du potentiel, et des limites de la pensée constructive attribuée aux acteurs du développement de la voûte plate : essentiellement M. Abeille, l’inventeur, mais aussi MM. Truchet, qui propose une variante, et Frézier, qui généralise le principe et analyse les tenants et aboutissants sur les plans théoriques et pratiques.
Bibliographie sélective :
François Fleury, Bernard Duprat, « Stabilité et dimensionnement des arcs et des piédroits par Antoine d’Alleman, architecte-ingénieur (1679-1760) », dans Gilles Bienvenu, Martial Monteil et Hélène Rousteau-Chambon (dir.), Construire ! Entre antiquité et époque moderne, Paris, Éditions Picard, novembre 2019
François Fleury, Rémy Mouterde, « La mécanique des charpentes : le cas de la cathédrale de St. Pierre à Poitiers » dans Les charpentes du XIe au XIXe siècle – Grand Ouest de la France : typologie et évolution, analyse de la documentation de la Médiathèque de l’architecture du patrimoine, Turnhout (Belgium), Brepols Publishers n.v., 2011, p. 177-200.
François Fleury, Joël Sakarovitch, « La voûte plate de Joseph Abeille : analyse du comportement structurel », in Roberto Gargiani (dir.), L’architrave, le plancher, la plate-forme, Nouvelle histoire de la construction, Lausanne, EPFL, 2012.
François Fleury, “Some Aspects of John Wallis’ Structural Mechanics.” in Nuts and Bolts of construction History, Culture, Technology and Society, (eds) R. Carvais, A. Guillerme, V. Nègre et J. Sakarovitch, Paris, Picard, 2012, 3 volumes.
François Fleury, Bernard Duprat, « Analysis of an unpublished treatise of an 18th century engineer, Antoine d’Alleman (1679-1760) », in Brian Bowen, Donald Friedman, Thomas Leslie and John Ochsendorf (eds.), Proceedings of the Fifth International Congress on Construction History, Chicago, 2015, 3 vol.
François Fleury & al. (dirs.), Les temps de la construction – processus, acteurs, matériaux, actes du deuxième congrès international de l’histoire de la construction, Paris, Édition Picard, 2016.